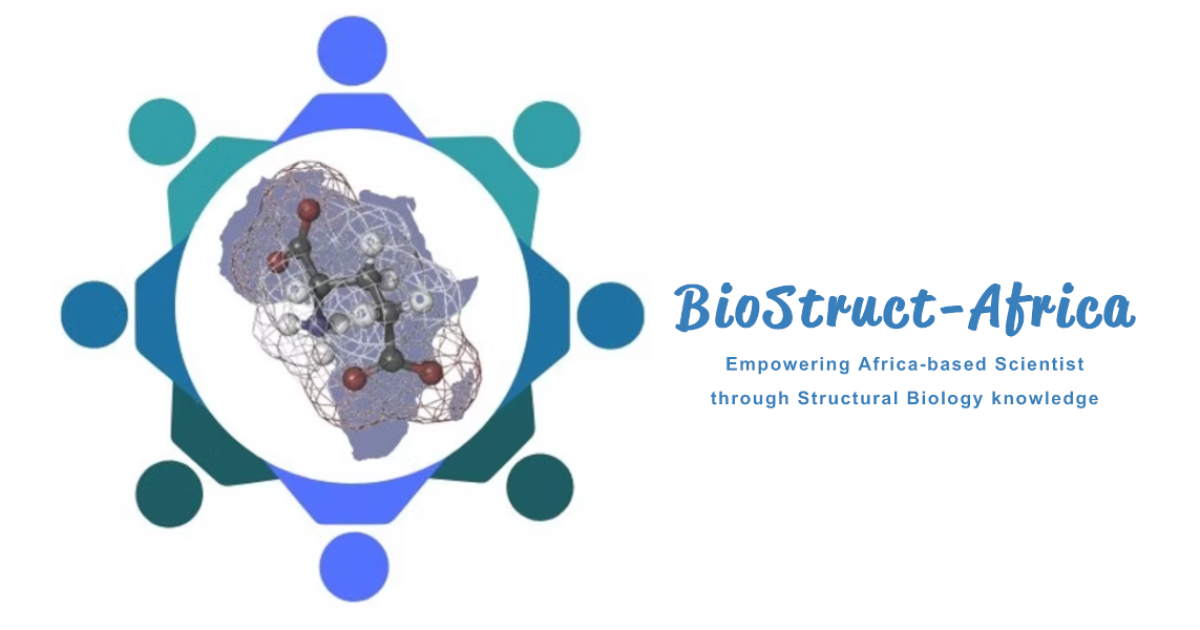Si l’on ne remédie pas au manque d’infrastructures de recherche, de financement et de politiques scientifiques favorables, les efforts de renforcement des capacités en biologie structurale en Afrique continueront d’être entravés par le défi persistant de la fuite des cerveaux
Le prix Nobel de chimie 2024 a une nouvelle fois mis en évidence le rôle transformateur de la biologie structurale dans la science moderne. Il a récompensé les contributions de David Baker à la conception des protéines et au développement d’AlphaFold, dirigé par Demis Hassabis et John Jumper, de Google DeepMind. AlphaFold est un outil d’IA de pointe permettant de prédire la structure 3D des protéines à partir de leur séquence d’acides aminés primaires. Il accélère et affine la modélisation des protéines, essentielle à la conception de médicaments fondés sur la structure, et pourrait ainsi contribuer à relever les défis mondiaux en matière de santé.
Mais AlphaFold est plus qu’un simple outil de prédiction de la structure des protéines. Il contribue aussi à la redéfinition des paradigmes de la collaboration scientifique et de la production de connaissances. En démocratisant l’accès à des modèles protéiques précis, il transcende les barrières traditionnelles, et permet à un plus large éventail de chercheurs de s’attaquer à des problèmes biologiques complexes. Par exemple, les chercheurs des pays africains, confrontés à des défis sanitaires urgents tels que le paludisme, la tuberculose, le VIH/sida, la fièvre de Lassa et la résistance aux antimicrobiens, ont désormais accès à des outils informatiques avancés qui leur étaient auparavant inaccessibles. Cette démocratisation donne aux scientifiques travaillant sur des questions sanitaires critiques spécifiques à leur région les moyens d’agir et illustre comment les innovations technologiques peuvent influencer à la fois les découvertes scientifiques et les cadres sociaux de la science, favorisant ainsi l’inclusion et accélérant les progrès de la recherche mondiale en matière de santé.
Faire progresser la biologie structurale en Afrique
AlphaFold1,2 est très prometteur pour faire progresser la biologie structurale en Afrique, où les défis sanitaires urgents nécessitent des technologies de pointe. En offrant une plateforme librement accessible, AlphaFold contribue à combler les lacunes en matière de ressources, démocratise l’accès aux technologies de pointe, et donne aux scientifiques les moyens de faire des découvertes cruciales. Cependant, comme le montrent les initiatives qui intègrent AlphaFold dans les programmes de formation des scientifiques de ces régions, la technologie seule ne suffit pas pour faire progresser la recherche en biologie structurale dans les pays africains. Un soutien complet, comprenant notamment du mentorat, des infrastructures et des financements, est essentiel pour exploiter pleinement son potentiel3.
L’initiative BioStruct-Africa, organisation à but non lucratif fondée en 2017 et enregistrée en Suède et au Ghana, se consacre au développement de l’expertise en biologie structurale à travers l’Afrique4,5. L’organisation propose des formations de pointe sur des techniques avancées, notamment la cryo-microscopie électronique (cryo-EM) et la cristallographie aux rayons X, complétées par un mentorat en ligne après les ateliers, afin de garantir le maintien des compétences à long terme et un impact durable. Dans le cadre de sa mission, BioStruct-Africa a intégré AlphaFold dans ses programmes de formation afin de faire progresser le domaine de la biologie structurale sur le continent. Récemment, pour la cinquième fois, elle a organisé un atelier au cours duquel des chercheurs en début de carrière et des étudiants de tout le continent ont acquis des compétences essentielles dans l’utilisation d’AlphaFold. L’atelier a suscité un vif intérêt. Parmi plus de 100 candidats très compétents, 20 participants ont été sélectionnés à l’issue d’un processus rigoureux qui privilégiait la diversité et garantissait une représentation équilibrée des sexes. Presque tous ont trouvé AlphaFold très pertinent pour leurs recherches actuelles et ont considéré qu’il s’agissait d’un atout précieux pour leurs compétences. La qualité de la formation a aussi été très appréciée, la plupart des participants se déclarant très satisfaits. Les commentaires indiquent que les participants se sentaient bien préparés à mettre en pratique leurs nouvelles compétences dans le cadre de leurs recherches en cours et à les enseigner à d’autres, ce qui constitue une étape importante vers l’objectif de BioStruct-Africa : créer une communauté de biologistes structuraux en Afrique, et favoriser les collaborations à travers le continent.
Installation dans les pays du Nord
Si les acquis en termes de compétences et de connaissances lors de l’atelier sont conformes à la mission de BioStruct-Africa, qui consiste à renforcer les capacités et à améliorer l’expertise en biologie structurale, une question clé est ressortie des commentaires : l’intention des participants de s’installer dans les pays du Nord pour poursuivre leurs études ou leur carrière, ainsi que leur recherche d’une formation plus pratique dans des laboratoires ou des infrastructures de recherche plus importantes.
Une grande majorité des participants ont exprimé un vif intérêt pour une expatriation de longue durée dans les pays du Nord, la moitié d’entre eux ayant déjà pris des mesures concrètes dans ce sens. Beaucoup avaient l’intention de rester à l’étranger à long terme, principalement pour poursuivre des études supérieures telles que des masters ou des doctorats. Interrogés sur les facteurs à l’origine de cette tendance, les participants ont cité les lacunes importantes des infrastructures de recherche, l’insuffisance des financements et l’accès limité aux possibilités de formation pratique dans leur pays d’origine. Ces résultats mettent en évidence deux problèmes majeurs : le manque d’opportunités pour les chercheurs en début de carrière et les étudiants qui souhaitent poursuivre des études de master ou de doctorat, et la difficulté de retenir les chercheurs en Afrique, qui, une fois qu’ils ont quitté le continent, ne reviennent souvent pas.
Besoin d’un environnement plus favorable
Les participants ont souligné qu’un investissement accru dans les laboratoires, les équipements et la formation pourrait combler le fossé entre les connaissances théoriques et leur application pratique, ce qui leur permettrait de travailler plus facilement dans leur pays. Ils ont aussi insisté sur l’importance d’un emploi stable, de réseaux de collaboration et d’un environnement favorable offrant un accès à une éducation de qualité, à des soins de santé et à des ressources pour les familles. Beaucoup estiment que ces améliorations créeraient un environnement de travail plus compétitif et plus sûr, réduisant ainsi la tendance à chercher des opportunités à l’étranger, qui risque d’appauvrir l’expertise scientifique de l’Afrique. Les chercheurs africains qui s’installent à l’étranger ont souvent des difficultés à revenir en raison du manque de financement et d’infrastructures dans leur pays d’origine. En outre, ceux qui restent à l’étranger peuvent réorienter leurs priorités de recherche vers celles de leurs institutions d’accueil, détournant ainsi l’attention des défis sanitaires urgents de l’Afrique. Ce cycle non seulement perturbe les progrès, mais affaiblit aussi les réseaux de formation et de mentorat essentiels à la mise en place d’une infrastructure et d’une communauté de recherche locales durables. Ces conclusions mettent en évidence deux défis majeurs : le nombre limité de possibilités de formation pour les chercheurs en début de carrière et les étudiants, et la difficulté à attirer les chercheurs qui choisissent souvent de rester à l’étranger après s’être déplacés pour suivre une formation initiale ou avancée.
Dans le même temps, les participants à l’atelier ont également souligné leur engagement en faveur du renforcement des capacités locales. La majorité d’entre eux ont indiqué qu’ils recommanderaient très probablement l’atelier à leurs pairs, ce qui suggère leur volonté de contribuer à l’épanouissement d’une communauté de praticiens de la biologie structurale en Afrique. Cet engagement envers l’engagement des pairs est un signe prometteur qui montre qu’avec les ressources adéquates, bon nombre de ces scientifiques préféreraient rester et contribuer à des recherches qui ont un impact direct sur leurs communautés.
Un écosystème plus large nécessaire à l’innovation scientifique
Ces commentaires soulignent le fossé qui existe entre les opportunités technologiques d’une part, et les conditions favorables en termes de politique scientifique et d’infrastructures d’autre part. Les ateliers BioStruct-Africa sur AlphaFold et les programmes de mentorat constituent un élément précieux du renforcement des capacités, mais ils ne sont qu’une partie d’un écosystème plus large nécessaire à l’innovation scientifique. Pour relever les défis mis en évidence et retenir les talents, il est essentiel de combler les lacunes en matière d’infrastructures et de ressources qui poussent les scientifiques à chercher des opportunités à l’étranger. Il est essentiel d’investir dans les infrastructures de recherche fondamentale, afin de créer un environnement dans lequel les scientifiques africains peuvent mener des recherches de haute qualité.
Le domaine de la politique scientifique visant à favoriser de meilleures opportunités locales est sans aucun doute en pleine évolution et prend de l’ampleur. Des initiatives telles que l’Institut africain de bioinformatique, créé en octobre 2024 avec le soutien du Wellcome Trust et de l’initiative Chan Zuckerberg, commencent à répondre à certains de ces besoins. Des instituts et des initiatives comme ceux-ci peuvent jeter les bases d’un écosystème de recherche plus autonome entre les pays africains. L’atelier BioStruct-Africa AlphaFold est un exemple réussi de l’impact immédiat que peut avoir une formation de haute qualité sur les compétences et la confiance des chercheurs locaux. Cependant, la question plus large de la fuite des cerveaux souligne la nécessité de changements systémiques pour soutenir le maintien à long terme des scientifiques formés.
L’intégration des technologies de pointe, des initiatives locales et des communautés scientifiques émergentes, soutenue par des efforts complémentaires en matière de politique scientifique, devraient fonctionner de concert pour créer un écosystème de recherche qui permettrait aux scientifiques de s’épanouir dans leur contexte local et régional, tout en maintenant des liens solides avec leurs pairs internationaux. Pour tirer pleinement parti du potentiel de programmes tels que BioStruct-Africa, les pays africains et les acteurs mondiaux doivent collaborer afin de soutenir des initiatives qui répondent aux besoins spécifiques de l’Afrique en matière de santé. Il sera alors possible non seulement de retenir les talents, mais aussi de catalyser une nouvelle ère d’innovation et de recherche en matière de santé, enracinée en Afrique et intégrée dans la science mondiale.
Emmanuel Nji, Biostruct-Africa & Département de parasitologie et de microbiologie, Centre de recherche sur les maladies infectieuses, Yaoundé, Cameroun ;
Katharina C. Cramer & Nicolas V. Rüffin, TILLER ALPHA GmbH, Bonner Talweg 64, 53113 Bonn, Allemagne ;
Fatoumata G. Fofana, Centre africain d’excellence en bio-informatique et sciences des données du Mali (ACE-B), Université des sciences techniques et technologiques de Bamako (USTTB), Bamako, Mali ;
Walid Heiba, Faculté de pharmacie, Université d’Alexandrie, Alexandrie, Égypte ;
Safiétou Sankhe, Unité Arbovirus et Virus de Fièvre Hémorragique, Département de Virologie, Institut Pasteur de Dakar, Dakar, Sénégal
Cet article a été publié par Nature Communications, sous licence CC BY 4.0.
Il a été traduit en français par Afriscitech. Les sous-titres et les liens ont été ajoutés par Afriscitech afin de faciliter la lecture.